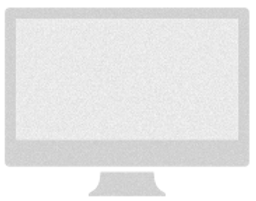

Prochaine conférence
2026
De retour en 2026 !
Résumé
...
Vous avez des travaux de recherche ou une étude de cas en lien avec les eaux souterraines à nous partager? Envoyez-nous un titre et un court résumé de votre projet !
Plongez dans plus d’une décennie de savoir partagé !
Depuis 2010, le RQES rassemble experts et toute une communauté autour de conférences sur les eaux souterraines. Explorez nos archives en PDF* et/ou vidéo*, et filtrez les présentations par année grâce au menu ci-dessous.
*Si le fait de cliquer sur l'icône n'ouvre pas une page, c'est que l'archive n'est pas disponible.
2 mai 2023
En route vers un Observatoire de l’eau souterraine: un premier inventaire des connaissances scientifiques sur les eaux souterraines du Québec
RÉSUMÉ
Le projet « En route vers un Observatoire de l’eau souterraine! » vise à dresser un premier inventaire des connaissances scientifiques récentes sur les eaux souterraines du Québec. Cet inventaire, disponible sur le Portail des connaissances sur l’eau, est structuré afin de faciliter la recherche des connaissances existantes par les acteurs et actrices de l’eau qui doivent répondre à des enjeux en lien avec les eaux souterraines de leur territoire.
Les chercheurs et chercheuses, acteurs et actrices de l’eau et du territoire ont participé à identifier et classifier les connaissances selon les régions et les problématiques étudiées, leur pertinence pour différentes phases de gestion, les enjeux de protection et de gestion auxquels elles peuvent contribuer, ainsi que les personnes-ressources sur différents sujets. En consultant l’inventaire, les acteurs et actrices de l’eau sauront quelles connaissances sont disponibles sur leur territoire, à quoi elles peuvent servir et à qui s’adresser pour obtenir des réponses à leurs questions sur des enjeux concrets, favorisant ainsi la discussion et la création de partenariats de recherche. Ce premier bilan des connaissances sur les eaux souterraines du Québec permet ainsi d’identifier les besoins en connaissances et d’éclairer les besoins de recherche.
Marie Larocque et Miryane Ferlatte
Chaire de recherche eau et conservation du territoire, UQAM et RQES
15 décembre 2022
Vers une meilleure gestion de l’alimentation en eau au Québec grâce à une approche globale de la vulnérabilité des eaux souterraines
RÉSUMÉ
Dans le sud du Québec, l’urbanisation galopante et les changements climatiques accroissent la pression sur les eaux souterraines, alors que 90 % du territoire habité dépend de cette ressource pour son approvisionnement en eau. Les outils actuels de caractérisation de la vulnérabilité (DRASTIC) reposent sur une perception strictement verticale de la fragilité des aquifères. Un couplage de ces outils avec de nouvelles approches s’avère nécessaire pour intégrer toutes les dimensions spatiales de l’écoulement de l’eau. Avec le soutien du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), ce projet a permis de construire un indice de résistance chimique (IRC) des eaux souterraines aux pollutions anthropiques.
Les données collectées dans 15 régions durant les « Projets d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines » (PACES), ont été discutées quant à leur qualité et leur représentativité pour la caractérisation des processus de minéralisation à l’échelle régionale. Les évolutions de la minéralisation de l’eau ont été représentées le long de lignes de flux théoriques, en tenant compte des principaux processus (altération, dilution, échange cationique, pollutions anthropiques). Puis, l’indice de résistance chimique a été construit en considérant à la fois le diagramme d’évolution hydrochimique (DEH) et deux sous-indices complémentaires pour les aquifères silicatés. Ces derniers sont soutenus par les tendances modélisées d’altération des minéraux définies sous PHREEQc. Enfin, l’IRC a été normalisé pour permettre la comparaison des résultats obtenus sur l’ensemble des régions étudiées.
L’agrégation de plusieurs sous-indices accroit la sensibilité de l’IRC, le rendant efficace aussi bien dans les petits aquifères granulaires que dans les grandes masses d’eau. En considérant les niveaux de nitrates dans les eaux souterraines, l’IRC a montré que seules les ressources en eau considérées comme de faible résistance sont impactées. Ensuite, l’IRC a été inclus sur une carte régionale pour discuter de l’influence du contexte local de chaque puits (réseau hydrographique, zones de recharge, cartes DRASTIC). Par rapport à DRASTIC, l’IRC semble être plus efficace pour identifier les sites impactés par la filtration sur berge et une contribution ascendante des aquifères régionaux ou des eaux de surface. Là où DRASTIC donne de bonnes informations sur le risque de pollution verticale, l’IRC intègre la vulnérabilité de toutes les lignes d’écoulement interceptées par le puits. De plus, comme il intègre l’impact de tous les processus affectant les eaux souterraines, depuis les zones de recharge jusqu’au puits de pompage, l’IRC donne un aperçu rapide et clair de la capacité des eaux souterraines à absorber les pollutions anthropiques où qu’elles se trouvent dans le bassin versant. Grâce à la contribution des équipes de recherche des PACES, ce travail exploratoire a conduit à la création d’un nouvel outil de protection des eaux, convivial et peu coûteux, qui peut être appliqué dans tous les contextes hydrogéologiques.
Karine Lefebvre
Chaire de recherche stratégique en hydrogéologie urbaine, UQAM
15 novembre 2022
Obstacles et pistes de solution en vue d’intégrer les ressources en eau souterraine dans les documents de planification régionaux
RÉSUMÉ
Entre 2009 et 2022, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a financé, par l’entremise du Programme d’acquisition des connaissances sur l’eau souterraine (PACES), la réalisation de projets permettant d’obtenir un portrait de cette ressource à travers les territoires municipalisés du Québec. En parallèle, des efforts ont été déployés par le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) pour transférer les connaissances des projets du PACES aux acteurs de l’eau régionaux. En dépit des efforts investis, on constate que ces connaissances ont été jusqu’ici très peu utilisées par les d’organismes de bassins versants (OBV) et les municipalités régionales de comté (MRC).
L’objectif de la présente étude est de faire ressortir les principaux obstacles que les acteurs de l’eau rencontrent dans leurs efforts pour intégrer les eaux souterraines dans leurs documents de planification de l’aménagement du territoire. Les travaux se basent sur des entrevues semi-dirigées et des ateliers collaboratifs effectués avec des acteurs de l’Estrie en vue d’élaborer un plan d’action sur les eaux souterraines devant être intégré dans le plan directeur de l’eau (PDE) de deux OBV. Les activités réalisées ont fait ressortir des actions envisageables pour le plan d’action ainsi que des constats sur l’état actuel de la gestion des eaux souterraines. L’analyse des constats formulés par les acteurs met en évidence des noeuds (obstacles ou manques) auxquels ils sont confrontés, mais et elle fait aussi ressortir les liens de causalité qui unissent ces noeuds. La chaine causale met en évidence l’importance de combler, en priorité, des manques au niveau du cadre institutionnel de gestion intégrée de l’eau par bassins versants (GIEBV) pour favoriser l’intégration des eaux souterraines dans les documents de planification régionaux. L’article propose une série de recommandations pour la mise en place de conditions plus favorables à une gestion durable de l’eau souterraine au Québec.
Renaud Delisle
Université Laval
12 octobre 2022
Discussion autour du guide d’appropriation des connaissances sur l’eau souterraine à des fins d’intégration au schéma d’aménagement et de développement : deux cas d’étude en Estrie
RÉSUMÉ
Un guide à l’attention des aménagistes a été produit, où chacun des indicateurs est expliqué en quatre questions sous forme de carte : ce que la carte représente, comment la carte a été produite, comment se servir de la carte et comment l’interpréter. Cette approche a pour objectif d’inspirer et de former les spécialistes dans le domaine.
De plus, un grand apport de ce projet au domaine de l’aménagement du territoire a été de définir un processus de priorisation des zones de recharge à protéger. Il constitue la deuxième partie du guide et consiste à prioriser les interventions à l’aide d’une grille. Le principe général de la priorisation des zones de recharge est que la protection d’une zone est prioritaire. Ensuite, les travaux ont permis d’explorer les rôles et les outils de l’aménagement par rapport à l’eau souterraine.
En complément, le mémoire de maîtrise associé au guide >>
Jimmy Mayrand
M. ATDR et candidat au doctorat, Université Laval





