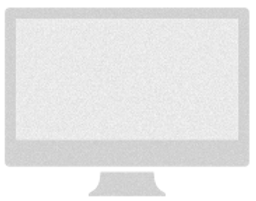

Prochaine conférence
2026
De retour en 2026 !
Résumé
...
Vous avez des travaux de recherche ou une étude de cas en lien avec les eaux souterraines à nous partager? Envoyez-nous un titre et un court résumé de votre projet !
Plongez dans plus d’une décennie de savoir partagé !
Depuis 2010, le RQES rassemble experts et toute une communauté autour de conférences sur les eaux souterraines. Explorez nos archives en PDF* et/ou vidéo*, et filtrez les présentations par année grâce au menu ci-dessous.
*Si le fait de cliquer sur l'icône n'ouvre pas une page, c'est que l'archive n'est pas disponible.
5 décembre 2025
Peut-on, grâce à l'IA, apprendre ou découvrir des modèles conceptuels hydrologiques à partir des données sans dépendre entièrement de l’expertise humaine ? Cas de DeepDiscover.
Les modèles conceptuels, souvent utilisés en hydrologie, représentent les bassins versants comme des réseaux de réservoirs interconnectés. Ils sont précieux pour comprendre les processus physiques, mais leur construction repose encore largement sur l’expertise humaine. La présente étude explore une question centrale pour l’hydrologie moderne : peut-on apprendre la structure de modèles conceptuels existants ou en découvrir de nouveaux directement à partir des données et des principes physiques généraux, sans dépendre entièrement de l’expertise humaine ? DeepDiscover propose une nouvelle approche qui combine apprentissage profond et principes physiques généraux afin de découvrir automatiquement la structure et les équations de tels modèles directement à partir des données. Dans le cadre d'une étude de validation de concept sur plus de 500 bassins versants aux Etats-Unis, DeepDiscover a démontré des performances de prédiction comparables ou supérieures à plusieurs modèles de référence, tout en reproduisant les dynamiques internes des processus hydrologiques du modèle EXP-HYDRO. Cette approche ouvre la voie à des modèles adaptatifs, interprétables et cohérents sur le plan physique, offrant un nouveau regard sur la modélisation hydrologique à l’ère des données massives.
Vincent Adombi
UQAC
15 mai 2025
De la caractérisation à la prédiction probabiliste du transport de masse: le cas de ville Mercier
RÉSUMÉ
Le site de ville Mercier a été intensément caractérisé et modélisé durant les 30 dernières années. Ce site, riche en connaissances accumulées, a nécessité une mise à jour de la part du ministère de l’environnement du Québec afin de tester des hypothèses de pompage pour optimiser le piège hydraulique. Grâce à ces nouvelles données, nous avons déployé une approche intégrée de caractérisation et modélisation transitoire de l’écoulement et du transport de masse en tenant compte des incertitudes liées aux mesures hydrogéologiques.
Erwan Gloaguen
INRS-ETE
6 décembre 2023
Le site de Ploemeur-Guidel, un observatoire de la zone critique
RÉSUMÉ
Depuis une vingtaine d’années, différentes structures d’observations se sont progressivement mises en place dans de nombreux pays pour acquérir sur le long terme des données d’observations sur les systèmes environnementaux naturels. Le site de Ploemeur-Guidel (Bretagne), lancé en 2002 sous la direction d’une équipe du CNRS et de l’Université de Rennes, a contribué à cette aventure en participant au réseau de sites hydrogéologiques H+. Le premier objectif de la création du site de Ploemeur-Guidel a été de fournir des données pertinentes – y inclus des chroniques ou expériences long terme – pour la caractérisation, la quantification et la modélisation des transferts d’eau, d’éléments et d’énergie dans les aquifères souterrains hétérogènes fracturés. L’une des problématiques principales était de caractériser et modéliser le rôle des failles et fractures dans les processus d’écoulement et de transport dans les aquifères cristallins. Pour cela, différentes approches associant géochimie, hydrogéologie, et hydro-géophysiques ont été développées.
Plus récemment, avec l’intégration du site au sein de l’infrastructure de recherche OZCAR sur les observatoires de la zones critique, les travaux sont devenus plus interdisciplinaires, en intégrant des questions liées aux interactions entre les eaux profondes et les eaux de surface, au développement bactérien dans le sous-sol ou encore à la gestion de l’eau selon l’occupation des territoires. L’objectif de la présentation sera d’essayer de retracer cette évolution vers l’interdisciplinarité au cours des vingt dernières années.
Olivier Bour
Géosciences Rennes
5 décembre 2023
ARIM’Eau : 6 ans de transfert circulaire des connaissances sur les eaux souterraines au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 6 ans d’accompagnement personnalisé des acteurs régionaux
RÉSUMÉ
Les universités québécoises ont fourni des efforts soutenus depuis les 15 dernières années pour élaborer un premier portrait des eaux souterraines du Québec méridional dans le cadre du programme d’acquisition des connaissances du Ministère de l’Environnement. Les données centralisées au sein d’une base de données unique doivent maintenant mener à une meilleure connaissance du fonctionnement hydraulique et des processus hydrogéochimiques des aquifères du Québec méridional, mais doivent aussi servir à orienter les décisions des instances municipales en charge de l’aménagement du territoire. Le projet ARIM’eau permet d’atteindre ces 2 principaux objectifs en créant un espace de proximité entre l’université, les organismes gouvernementaux (ex. organismes de bassin versant), les municipalités régionales de comté et la communauté des Premières Nations du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le projet ARIM’eau est articulé autour de quatre grands axes :
Accompagnement et interaction avec les intervenants du milieu dans les problématiques liées aux eaux souterraines;
Recherche appliquée sur les eaux souterraines;
Implantation et transfert des résultats issus du PACES-SLSJ et des réalisations ARIM’eau;
Mise à jour de la base de données géospatiale régionale issue des PACES-SLSJ en intégrant les nouvelles données.
Cet espace de concertation permet l’identification d’enjeux régionaux en lien avec l’eau souterraine, la mise sur pied de projets intégrés, ainsi que la formation d’une relève professionnelle scientifiquement compétente et consciente des réalités territoriales. Le projet pilote a vu le jour en décembre 2017, pour une durée initiale de 3 ans, et a été reconduit pour 3 années supplémentaires. Concrètement, durant la première période (2017 – 2020), le projet ARIM’eau a permis la réalisation de 16 projets portant sur des enjeux régionaux, dont 7 projets de recherche menés par des étudiants. De plus, 6 ateliers d’implantation et de transfert des données ont été réalisés au sein des instances régionales d’aménagement du territoire, et 6 nouveaux atlas sur les eaux souterraines sont maintenant disponibles et diffusés gratuitement auprès de la population locale. ARIM’eau permet à l’université de jouer pleinement un rôle de pôle d’expertise régional, et aux décideurs d’accéder facilement à cette expertise pour garantir la pérennité des ressources en eau potable régionales dans un contexte de changement climatique.
Julien Walter et Nathalie Audet
UQAC et MRC de Lac-Saint-Jean-Est





