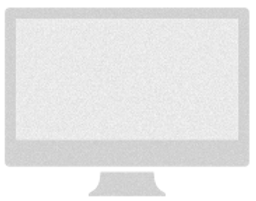

Prochaine conférence
2026
De retour en 2026 !
Résumé
...
Vous avez des travaux de recherche ou une étude de cas en lien avec les eaux souterraines à nous partager? Envoyez-nous un titre et un court résumé de votre projet !
Plongez dans plus d’une décennie de savoir partagé !
Depuis 2010, le RQES rassemble experts et toute une communauté autour de conférences sur les eaux souterraines. Explorez nos archives en PDF* et/ou vidéo*, et filtrez les présentations par année grâce au menu ci-dessous.
*Si le fait de cliquer sur l'icône n'ouvre pas une page, c'est que l'archive n'est pas disponible.
25 septembre 2013
Management des flux hydriques à Bruxelles
RÉSUMÉ
Cette étude décrit les cycles hydriques et tente de quantifier à l’aide d’outils isotopiques (∂D, ∂18O et ∂15N,..) les différentes masses d’eau (pluie, souterraine, domestique…) impliquées dans les réalités urbaines, historiques et hydrogéologiques Bruxelloises. Cette approche initiée dans un contexte de prévention ou de réduction des inondations récurrentes dans les fonds de vallée, s’élargit pour contribuer à grande et petite échelles au planning urbain de demain et à la gestion durable des eaux en ville.
Philippe Claeys
Vrije Universiteit, Brussel
17 avril 2013
Reconnaissance de la structure des écoulements souterrains, un prérequis aux datations et calculs de la recharge
RÉSUMÉ
Pour comprendre et estimer l’impact et les différents aspects des changements environnementaux qui forcent les différents compartiments du cycle de l’eau, les outils géochimiques sont de plus en plus utilisés. Ils permettent de discuter des flux au sein des masses d’eau et aux interfaces entre les différents compartiments du cycle de l’eau, par exemple pour estimer la recharge. Les isotopes radioactifs naturels − comme le carbone-14 et l’argon-39 − et les traceurs d’activité anthropique − tels les CFCs, le SF6 et le Kripton-85 − sont de parfaits candidats à la datation des eaux souterraines. La tentation de donner un âge « traceur » est grande... Mais contrairement aux autres objets géologiques, l’eau souterraine est en écoulement continu. L’échantillon à dater est le fruit d’une dynamique active jusqu’à l’échantillonnage. Que représente-il ? Est-il vraiment logique de parler d’âge de l’eau ? Avec l’exemple de projets de recherche en cours, quelques voies de réflexion seront explorées pour aborder la notion de structure des écoulements souterrains et d’âge de l’eau.
Florent Barbecot
UQAM
13 mars 2013
Exfiltration d’égouts : la contamination des eaux de surface par voie souterraine
RÉSUMÉ
La contamination microbiologique des sources d’eau potable en milieu urbain provient principalement des rejets d’eaux usées non traitées ou partiellement traitées, des raccordements inversés et des débordements d’égouts sanitaires ou unitaires. Pour les eaux souterraines en milieu urbain, l’exfiltration des égouts sanitaires ou unitaires peut augmenter le risque de contamination des nappes phréatiques. De plus, les égouts à proximité des prises d’eau potable (eaux de surface) peuvent contribuer à la contamination microbiologique de celles-ci s’il y a de l’exfiltration et l’écoulement vers les prises d’eau. La rupture d’un égout est également un scénario à considérer lors des études de vulnérabilité pour la protection des sources d’eau potable.
Cette présentation d’une étude de cas d’une prise d’eau ayant une contamination microbiologique faible démontre qu’une petite quantité d’eau sanitaire exfiltrée pourrait avoir un effet mesurable sur la qualité microbiologique d’un cours d’eau. La modélisation de l’égout et des eaux souterraines a démontré qu’une contamination par exfiltration pourrait se rendre au cours d’eau. Plusieurs méthodes de dépistage de sources de contaminants ont été utilisées lors de campagnes d’échantillonnage, mais n’ont pas réussi à clairement identifier la source de contamination fécale. Le bilan de masse sur les concentrations d’E. coli démontre que l’exfiltration d’égout explique mieux les concentrations mesurées à la prise d’eau que d’autres sources telles que la faune sauvage dans le cours d’eau.
Sarah Dorner
École Polytechnique de Montréal





